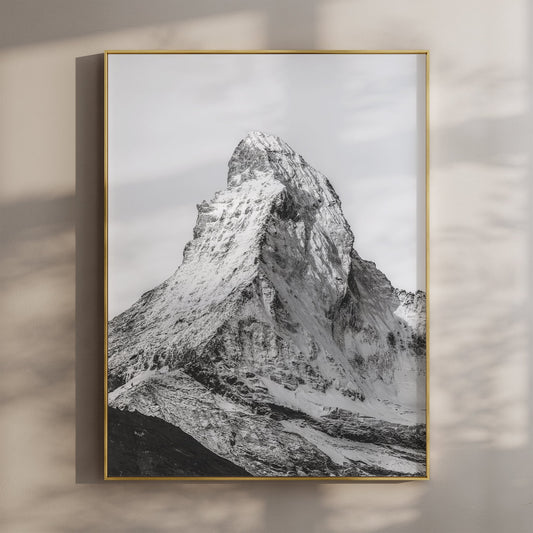Sensibilisation aux avalanches : Partie 4 : Observations sur le terrain et tests du manteau neigeux : Évaluation de la stabilité en terrain avalancheux
Partager
Dans la première partie de ce cours en 7 parties sur la sécurité en cas d'avalanche , nous avons exploré les principaux types d'avalanches, leurs causes et les risques qu'elles présentent. Dans la deuxième partie, nous avons abordé l'équipement essentiel en cas d'avalanche, en insistant sur l'importance de porter et de s'entraîner avec les bons outils. La troisième partie s'est concentrée sur la reconnaissance du terrain avalancheux, vous apprenant à identifier les caractéristiques et les conditions qui augmentent les risques.
Vous avez manqué la partie 3 ? Cliquez ici.
S'appuyant sur ces connaissances, cette quatrième section examine comment évaluer le manteau neigeux en temps réel. Les avalanches ne concernent pas seulement le terrain : elles concernent aussi la neige elle-même, un système dynamique qui évolue constamment avec les variations de météo, de température et de vent.
En terrain avalancheux, l'évaluation continue du manteau neigeux est essentielle pour assurer la sécurité. Bien qu'aucun test ou observation ne garantisse à lui seul la sécurité, la combinaison de techniques telles que l'observation visuelle, l'écoute des signes avant-coureurs et la réalisation de tests du manteau neigeux peut fournir des informations précieuses sur sa stabilité.

Cette section vous apprendra à analyser le manteau neigeux, à reconnaître les signes d'instabilité et à réaliser des tests efficaces sur le terrain. En acquérant ces compétences, vous serez mieux armé pour anticiper les risques et prendre des décisions plus éclairées et plus sûres. C'est parti !
En explorant la beauté de la vallée de Chamonix, pourquoi ne pas rapporter un peu des Alpes chez vous ? Notre boutique d'impressions sur le thème de Chamonix propose une sélection soignée de superbes reproductions d'art inspirées des paysages grandioses de la région. Des paysages de montagne spectaculaires aux paisibles vallées alpines, nos reproductions sont le souvenir ou le cadeau idéal pour tout amoureux de la montagne.
Suivez-nous sur Instagram @chamonixprints pour une inspiration quotidienne, des aperçus des coulisses des Alpes et des offres exclusives. Partagez vos photos d'aventure avec #ChamonixPrints ; nous serions ravis de voir vos aventures à Chamonix !

Drapeaux rouges visuels : des indices que vous pouvez repérer sans outils
Certains signes visuels peuvent indiquer des conditions de neige dangereuses. Soyez toujours attentif à ces « signaux d'alerte » pendant votre trajet :
- Avalanches récentes à proximité
- Signification : Si des avalanches se sont produites naturellement dans la région, c'est un indicateur fort d'instabilité des conditions de neige. Recherchez des débris d'avalanche frais, des corniches brisées ou des fractures de couronne (bord supérieur d'une plaque de neige).
- Conseil pratique : traitez les pentes proches des glissements de terrain récents avec une extrême prudence : elles peuvent encore être prêtes à subir un autre glissement.
- Bruits « Whumpfing »
- Signification : Un « whumpf » est le bruit d'une couche fragile qui s'effondre sous votre poids, signe évident d'instabilité du manteau neigeux. Ce phénomène se produit souvent dans les zones où les couches fragiles sont enfouies, comme la neige à facettes ou le givre de surface.
- Conseil pratique : Si vous entendez un bruit sourd, reculez immédiatement vers un terrain plus sûr. C'est l'un des indicateurs de danger les plus fiables.
- Des fissures dans la neige se propagent vers l'extérieur
- Signification : Les fissures qui rayonnent de vos skis, de vos bottes ou de votre planche indiquent que la tension se propage dans le manteau neigeux, un précurseur des avalanches de plaques.
- Conseil pratique : Évitez les pentes où les fissures se propagent facilement. C'est un signe évident d'instabilité de la dalle.
- Neige lourde, humide ou « granuleuse » sous les pieds
- Signification : Les couches de neige denses, humides ou glaciales sont plus sujettes au glissement, surtout si elles sont mal adhérentes aux couches inférieures. Ce phénomène est fréquent après une période de chaleur, de pluie ou de vent.
- Conseil pratique : Testez la neige en isolant de petits blocs avec votre bâton ou votre pelle pour vérifier les liaisons faibles entre les couches.

Liste de contrôle rapide pour les signaux d’alarme visuels :
- Débris d'avalanche frais.
- Des bruits de « Whumpfing ».
- Propagation des fissures.
- Neige dense, humide ou en plaques.
Tests du manteau neigeux : des outils pour approfondir les connaissances
Si les signaux d'alarme visuels sont essentiels, les tests du manteau neigeux fournissent des informations plus détaillées sur la stabilité. Ces tests permettent d'identifier les couches fragiles et d'évaluer leur risque de rupture. Cependant, leur réalisation correcte nécessite de la pratique.
1. Test de compression (CT)
- Objectif : Identifier les couches faibles et évaluer la facilité avec laquelle elles cèdent sous pression.
- Comment le réaliser :
- Creusez une fosse sur une pente représentative (aspect, élévation et angle similaires à l’endroit où vous prévoyez de voyager).
- Isoler une colonne de neige d’environ 30 cm de largeur et 30 cm de profondeur.
- Tapez sur le haut de la colonne avec une force croissante :
- 10 tapotements légers : en utilisant uniquement votre poignet.
- 10 tapotements moyens : en utilisant votre avant-bras.
- 10 coups durs : en utilisant tout votre bras.
- Observez où la colonne se fracture et notez la profondeur de la couche faible.
- Que rechercher :
- Des effondrements soudains après des coups légers ou moyens indiquent une couche faible et instable.
- Une rupture progressive (rupture après de nombreux coups) suggère un manteau neigeux plus stable.
Limites : L'essai de compression évalue uniquement la stabilité locale. Il est donc important de le combiner avec d'autres observations.
2. Test de colonne étendu (ECT)
- Objectif : Évaluer si une couche faible propagera une fracture, un facteur critique dans la formation d’avalanches de plaques.
- Comment le réaliser :
- Creusez une fosse plus large (30 cm x 90 cm) et isolez la colonne en coupant les côtés et l'arrière.
- Appliquer des taraudages comme dans le test de compression.
- Faites attention aux fractures qui s’étendent sur toute la colonne.
- Que rechercher :
- Les fractures qui se propagent sur toute la colonne indiquent un risque élevé d’avalanche.
- Les fractures qui ne se propagent pas suggèrent une instabilité plus localisée.
Pourquoi c'est important : Un manteau neigeux composé de couches fragiles qui propagent des fractures est plus susceptible de produire de grandes avalanches de plaque dangereuses.
3. Test de cisaillement à la main
- Objectif : Un test rapide pour évaluer les liaisons faibles entre les couches de neige.
- Comment le réaliser :
- Creusez dans la neige pour exposer un petit bloc.
- Appliquez une pression avec votre main pour voir si le bloc glisse facilement.
- À surveiller : Un cisaillement facile indique une liaison faible et un risque d’avalanche plus élevé.
Limites : L'essai de cisaillement manuel est simple mais moins précis que les essais de compression ou de colonne étendue.
4. Test de tapotement profond
- Objectif : Identifier les couches fragiles enfouies dont la profondeur est supérieure à 100 cm.
- Comment le réaliser :
- Isoler une colonne de neige qui s’étend jusqu’à la profondeur d’intérêt.
- Utilisez des coups fermes et contrôlés avec la lame de votre pelle pour voir si les couches profondes échouent.
- À surveiller : Les couches fragiles de plus de 100 cm de profondeur sont plus difficiles à déclencher, mais peuvent produire des avalanches massives si elles échouent.
Quand et où effectuer les tests
Choisir une pente représentative :
- Choisissez une pente qui reflète les conditions du terrain que vous prévoyez de parcourir :
- Même orientation (par exemple, orientée au nord).
- Élévation similaire.
- Angle comparable (par exemple, 30°–40°).
Le timing est important :
- Effectuez des tests après des événements météorologiques récents, tels que de fortes chutes de neige, des vents violents ou un réchauffement climatique. Ces événements constituent souvent des points de bascule du risque d'avalanche.
Limites des tests du manteau neigeux
Aucun test n'est infaillible. Les conditions d'enneigement peuvent varier considérablement sur une même piste ; il est donc important de combiner les résultats du test avec des observations visuelles et des informations météorologiques. En cas de doute, privilégiez la prudence et privilégiez les terrains plus sûrs.
Exemple pratique : combiner observations et tests
Vous prévoyez de skier sur une pente exposée nord après une tempête qui a apporté 40 cm de neige fraîche. À l'approche, vous remarquez :
- Débris d'avalanche frais sur une pente voisine.
- Un bruit de « whumpf » sous les pieds.
- Propagation de fissures dans la neige.
Vous effectuez un essai de compression et observez un effondrement soudain après de légers coups, confirmant une couche fragile enfouie à 40 cm de profondeur. Un essai de colonne étendu montre que la fracture se propage à travers la colonne.
Décision : Cette pente est trop dangereuse à skier. Vous décidez de vous en tenir à un terrain à faible inclinaison, inférieure à 30°.
Points clés à retenir
Les observations sur le terrain et les analyses du manteau neigeux sont des outils puissants pour évaluer le risque d'avalanche, mais ils ne constituent pas une garantie. Utilisez-les en complément des signaux d'alerte visuels, de votre connaissance de la météo et de votre connaissance du terrain. Surtout, en cas de doute sur les conditions, choisissez l'itinéraire le plus sûr : rien ne remplace un bon jugement en hors-piste.
Prêt à passer à la leçon suivante ? Cliquez ici pour accéder au chapitre 5 : Influence de la météo sur le risque d'avalanche.